|| Chroniquer ? ||
J'ai tenu un fanzine de Rock pendant dix ans. Tout d'abord comme rédacteur en chef puis seul homme à tout faire puisque la vie et ses vicissitudes m'ont séparé des autres rédacteurs après seulement quatre numéros. Sous la plume de Calhoun Mooney, j'y étais bien plus à l'aise dans le dénigrement, la moquerie et la contradiction que dans l'indulgence. Rien n'a changé car tout était sincère, il faut dire que le milieu alternatif - je parle ici des vrais indépendants, pas des inrockuptibles ou des fins de catalogue de Major qui distillent leurs vidéo-clips estampillés indé sur la TNT, la nuit venue - ne regorge pas de pépites, comme ses acteurs le proclament à l'envi. Il était donc facile de pratiquer une scolie moqueuse. Néanmoins, le but n'a jamais été de rabaisser quiconque ni de blesser. Je n'ai jamais affirmé qu'une chose : mon opinion personnelle n'engage que moi. C'est bien à cela que je renvoie quiconque me lit. Tout ce qu'on peut trouver dans cette section, comme ailleurs sur ce site - sauf indication contraire - n'est que l'expression de mon opinion, mon ressenti, mes idées ; inutile de penser que je suis dans le faux, personne ne l'est à avancer des sentiments personnels. Les chroniques qui suivent ne font que refléter ce que je suis parce que quand j'argumente un choix esthétique, je parle de moi. J'ajoute une note très ancienne (2012) qui illustre bien mes positions sur le sujet :
On me dit parfois - plus particulièrement lorsque j'émets une opinion esthétique ; que je suis négatif ou même que je suis exigeant. La plupart du temps, il m'est reproché mes critiques (puisque c'est à cela que mes paroles sont réduites) et leur ton moqueur. Parce que je brocarde les industries et leurs productions spectaculaires qui ne me conviennent pas et que j'y vois une entreprise aussi mercantile que despotique (1). Exemple frappant de cet aveuglement : au retour du concert aux arènes de Nîmes du groupe Radiohead, je me suis entendu dire parce que je donnais mon avis, que je n'étais « pas capable de faire le dixième de ce qu'ils font ». Remarque parfaitement hilarante, sauf à considérer la virtuosité ou les moyens financiers comme des talents. La première est une compétence, la seconde une opportunité. Aucun des deux ne fait la passion, denrée indispensable au talent. Au-delà de l'argument vite dégonflé, je vois surtout la victime d'un système qui, jamais, ne cherche à voir plus loin que ce qu'on lui met sous le nez, principe même de la publicité. Une victime qui, non seulement est inconsciemment convaincue que ce qui se voit, fait du bruit, de l'argent et réunit beaucoup de monde, mérite d'être vu, lu, entendu. C'en est devenu l'argument de tous les marchands d'illusions des chaines hertziennes à qui on reproche leur démagogie, pour faire court. « Bon sang, mais dire que je présente des émissions de merde, c'est dire que les X millions de téléspectateurs de cette même émission sont des cons qui aiment la merde ! » Ce à quoi je réponds « Oui, bien sûr » (voir ailleurs sur le site).
(1) Despotique parce que dotée d'un arsenal de méthodes insidieuses dont l'efficacité n'est plus à démontrer.
Destroyer, Karyn Kusama (2018)
 Hormis aux Stètes où ils aiment tout, sans discernement, au seul prétexte que cela existe (amaziiiing !), Destroyer est un film mal aimé. Quand ce n'est pas à cause de la métamorphose de Kidman qui fait dire aux commentateurs que la seule raison d'exister de ce long métrage est la recherche de l’Oscar ; c’est le cortège des plaintes philistines : « Trop lent », « Ça castagne pas assez ».
Hormis aux Stètes où ils aiment tout, sans discernement, au seul prétexte que cela existe (amaziiiing !), Destroyer est un film mal aimé. Quand ce n'est pas à cause de la métamorphose de Kidman qui fait dire aux commentateurs que la seule raison d'exister de ce long métrage est la recherche de l’Oscar ; c’est le cortège des plaintes philistines : « Trop lent », « Ça castagne pas assez ».
À titre personnel, j’ai pris un bon direct dans le ventre avec Destroyer ; j’ai trouvé que ça castagnait suffisamment. Je me balance pas mal de l’aspect qu’ils ont donné à l’actrice principale, je me contrefous de sa carrière, qu’elle cherche son Graal sous forme de statuette ne m’émeut pas, que Kusama ait tout fait pour mitonner un film à Oscar ne m’empêchera pas de dormir ce soir… Quand je regarde un film, je veux qu’on me raconte une histoire, le reste n’est même pas annexe, je m’en balance. Film à Oscar, pourquoi pas s’il me fait rêver !
On peut trouver Destroyer trop lent, on peut trouver qu’il manque d’action… c’est se tromper de film ou de désir. Kusama n'est pas Michael Mann ni Friedkin, mais Destroyer n’est ni Manhunter ni Heat, ce n’est ni To Live and Die in L.A. ni The French Connection. Destroyer est un film féminin et peut-être féministe, en tout cas c’est un sacré portrait de femme. Un portrait sombre. C’est d’ailleurs le cas de tous les longs métrages de la réalisatrice. Destroyer ne manque pas de rythme, il suit les pas de Erin ; Destroyer ne manque pas d’action, il ne s’y engage que contraint, comme Erin.
Après avoir vu tous ses films moins Girlfight qui sera, j’en fais le pari, son plus personnel et son plus viscéral parce qu’écrit par elle, il me semble juste d’affirmer que Kusama sait y faire, pas seulement pour être efficace (elle n’a pas peur de la violence ni du réalisme), mais aussi pour émouvoir (scènes intimistes ou plans rapprochés saisissants). Ses femmes sont fortes, indépendantes, mais aussi fragiles, contradictoires, hésitantes ou cramés, désespérément cramées comme Erin. Même la cruche (Megan Fox) de Jennifer’s Body recèle ses petits secrets inattendus.
Destroyer est un film noir, comme un film des frères Coen, sans le second degré. Destroyer en met plein la gueule de tous ses personnages jusqu’à la mort, jusqu’au bout, même après l’ultime rebondissement.
Vite, Girlfight !
P.S : j'aurais voulu voir ce film avec toi, Carole, et en discuter au pied de ton lit, dans ta chambre d'étudiant, rue Finsonius, avec du café noir.
Jennifer's Body, Karyn kusama (2009)
 2009 et Karyn fait son film d'ado.
2009 et Karyn fait son film d'ado.
Scénario prétexte, personnages archétypaux de la cult... eh oui, même pour ces individus, c'est de la culture au sens sociologique du terme... culture américonne, bande-son archétypale de cette même fédération d'états... un produit de consommation courante comme ils en financent tant. Un produit si archétypal et ne faisant appel à aucune ressource humaine qu'il pourrait s'en produire à la chaîne du côté de Pékin, à moindre coût. Si dispensable que c'est à désespérer de l'être humain quand on voit que le scénario est de Diablo Cody. Où est l'erreur de parcours ? Jennifer's Body ou Juno ? Je préfère ne jamais savoir...
XX, Four Killer Women (2017)
 J'aime bien explorer, alors j'ai commandé le DVD de l'anthologie XX à une connaissance de l'Interzone. Four deadly tales by four killer women !
J'aime bien explorer, alors j'ai commandé le DVD de l'anthologie XX à une connaissance de l'Interzone. Four deadly tales by four killer women !
Le lendemain, je recevais le disque.
Pourquoi ce film ? Tout bonnement parce que le quatrième segment est l’œuvre de Karyn Kusama. Un segment écrit et dirigé par Karyn !
Revenons en arrière :
The Box, premier court, a tout de l’histoire brève contée par Richard Matheson. C’est concis, mystérieux jusqu’à la dernière seconde et frustrant ou excitant, selon qu’on est un contemporain gavé de facilité ou curieux et imaginatif.
The Birthday Party est amusant trois minutes, pas imaginatif une seconde et définitivement prévisible.
Don’t Fall n'a strictement aucun intérêt !
Enfin, Her Only Living Son de Mary Kusama, me fait dire que la réalisatrice possède bien un style ; diffus, certes ; style qui sied à cette histoire, sorte de suite putative de Rosemary’s Baby. J’ai retrouvé ce goût pour le mystère qui a fait de The Invitation une réussite et une narration bien moins binaire que celle des trois autres courts métrages de XX.
Je vais peut-être voler la cassette de Girlfight, moi…
Oh, encore un détail : qu’il s’agisse d’une anthologie féminine ne change rien à rien, cela n’est qu’un argument promotionnel…
Aeon Flux, Karyn Kusama (2005)
 L’autre soir, après un inexplicable épisode nauséeux, j’ai voulu tester mon nouveau magnétoscope avec une cassette facile à lire pour ne pas le brusquer. Tout comme il est sage de ne pas laver des habits neufs à haute température, il est raisonnable de ménager les appareils embarquant de l'électronique dans leurs premiers jours de vie. Pour un magnétoscope, il faut utiliser des films inoffensifs. J’ai donc glissé la cassette d’Aeon Flux dans le lecteur et…
L’autre soir, après un inexplicable épisode nauséeux, j’ai voulu tester mon nouveau magnétoscope avec une cassette facile à lire pour ne pas le brusquer. Tout comme il est sage de ne pas laver des habits neufs à haute température, il est raisonnable de ménager les appareils embarquant de l'électronique dans leurs premiers jours de vie. Pour un magnétoscope, il faut utiliser des films inoffensifs. J’ai donc glissé la cassette d’Aeon Flux dans le lecteur et…
Karyn Kusama n’est pas connue pour son génie. Je l’ai rencontrée avec The Invitation, thriller de petite envergure qui doit tout à ses auteurs dont Karyn ne fait pas partie. Aeon Flux vient après Girlfight qui, semble-t-il, fut un succès critique. Aeon Flux, adaptation ciné... transposition sur grand écran d'une série... de petit écran...
La digression élève l'homme...
Adapter, transposer, grimer, faire passer pour... tous ces procédés qui n'ont qu'un but : vendre plus de merde. Parce qu'enfin, un livre se suffit à lui-même, le mettre en images c'est voler l'imagination des gens ; il en est de même pour une série ou une bande dessinée. Je crois que c’est Alan Moore qui s’est mis à refuser qu’on adapte ses histoires dessinées au cinéma, car elles étaient conçues comme des histoires dessinées et pas autrement…
La digression élève l'homme...
Je ne sais si Aeon Flux ressemble à la série (il y a fort à parier que c’est le cas), mais Aeon Flux ressemble bigrement à un film ou une série de science-fiction des années 50-60. C’est-à-dire à quelque chose auquel on ne croit plus depuis les années 70, au mieux. Décors (fauchés, génériques), costumes (grotesques), dialogues (anémiés), réalisation (robotique) typiques d’un Star Trek avec Leonard Nimoy.
Aeon Flux, c’est aussi la confirmation des accommodements d’une actrice qui aurait pu devenir icône d’un genre artistique et qui a tout fait pour devenir industriellement profitable. On la voit presque nue dans le film – rien ne le justifie – et son jeu est au-delà de la caricature.
Alors, je veux bien croire que Aeon Flux, le film, est conforme à son modèle ; je ne le vérifierai jamais et je ne m’en plains pas ; mais alors, à quoi bon ? On en revient à la nature des œuvres conçues pour un format et pas un autre.
Le profit et sa justification libérale corrompt tout.
Oh, j’oubliai un détail : l’intrigue, l’histoire, le scénario, les idées, enfin le récit sont, encore une fois, dilués dans une émulsion sirupeuse faite d’action, de combats et de rebondissements qui font oublier que ce film aurait pu avoir des choses à dire sur notre société, notre présent…
Las !
The Invitation, Karyn Kusama (2015)
 « The Invitation, thriller de petite envergure qui doit tout à ses auteurs dont Karyn ne fait pas partie. » Ainsi parlait l’autre truffe au sujet de ce long métrage de Karyn Kusama.
« The Invitation, thriller de petite envergure qui doit tout à ses auteurs dont Karyn ne fait pas partie. » Ainsi parlait l’autre truffe au sujet de ce long métrage de Karyn Kusama.
Je suis souvent d’accord avec ce garçon qui se cache derrière ce pseudonyme et c’est encore le cas pour The Invitation. Karyn n’a fait que tenir la caméra ; ce qui n’est qu’une figure de style pour dire qu’elle a dirigé une équipe de cadreurs ; pour mettre en images une histoire. Et c’est en ça que Karyn ne peut être associée au succès relatif du film. De fait, Girlfight est le seul film qu’elle a écrit. Son premier, lorsqu’elle était encore innocente, un peu comme Betty Elms. On sait ce qui arrive à ces pauvres créatures qui ne savent pas distinguer un dollar du bonheur.
Bref !
The Invitation est correctement filmé, c’est tout à l’honneur de Karyn, mais il est aussi très correctement développé dans une ambiance qui ressemble à une paire de mains élégantes qui se referment inexorablement sur un cou gracile.
Que ce soit un film qui traite du deuil parental ou de l’emprise sectaire importe peu, les deux sont étroitement liés dans le film et cela fait sa force. Pas d’esbroufe visuelle ; nous l’avons vu ailleurs dans ces pages, Karyn n’est pas un génie, elle porte correctement la caméra ; mais quelques acteurs plus ou moins confirmés qui n’en font pas trop là où d’autres grimaciers californiens auraient pu compromettre l’instant.
Le seul point noir, mais noir, de ce film réside dans ses dernières images qui laissent entendre quelque chose que je ne veux pas entendre et qui se répète presque image pour image dans 1BR, The Apartment dont j’ai parlé dans ces colonnes.
Pour bien faire, il faudrait visionner The Invitation sans même savoir qu’il existe et appuyer sur la touche Stop du magnétoscope après 1h34 de film sur 1h40…
Buried Alive, Frank Darabont (1990)
 En plus d'être un téléfilm, Buried Alive fut tourné en 1990, ce qui en fait une cible potentielle pour de nombreuses escadres de quolibets prêtes à décoller. Pourtant, on notera que l'idéal hollywoodien est respecté : pas de questionnement, suspension de crédulité, rapidité, histoire ficelée, mouvements de caméra. Comme chez Netflix, comme depuis plus d'un siècle. Mais, nous sommes en 2024 - du moins au moment où je tape ces mots - et l'humeur a changé, l'exigence est au standard hystérique. Il n'y a pas de super-héros(1) dans Buried Alive, bien au contraire, les trois personnages principaux sont de bons gros crevards sans foi ni loi qui cachent bien leur jeu. Le quatrième est si naïf qu'il est effrayant. Et la morale... œil pour œil, dent pour dent et ça passe crème, le film est américon tout de même.
En plus d'être un téléfilm, Buried Alive fut tourné en 1990, ce qui en fait une cible potentielle pour de nombreuses escadres de quolibets prêtes à décoller. Pourtant, on notera que l'idéal hollywoodien est respecté : pas de questionnement, suspension de crédulité, rapidité, histoire ficelée, mouvements de caméra. Comme chez Netflix, comme depuis plus d'un siècle. Mais, nous sommes en 2024 - du moins au moment où je tape ces mots - et l'humeur a changé, l'exigence est au standard hystérique. Il n'y a pas de super-héros(1) dans Buried Alive, bien au contraire, les trois personnages principaux sont de bons gros crevards sans foi ni loi qui cachent bien leur jeu. Le quatrième est si naïf qu'il est effrayant. Et la morale... œil pour œil, dent pour dent et ça passe crème, le film est américon tout de même.
Un petit thriller qui a 34 ans, même pas de quoi croquer dans un paquet de pop-corn, juste de quoi se dire « Ah ouais, pourquoi pas. » et passer à autre chose. Ou pour revoir Jennifer Jason-Leigh...
(1) au sens figuré, bien entendu
Linkeroever, Pieter Van Hees (2008)
 Hier soir, j'ai dérobé la cassette vidéo de Linkeroever dans le sac d'une grand-mère. Que faisait-elle là (la cassette, pas la mamie) ? l'histoire ne le dira jamais. L'Histoire, elle, devrait raconter que Linkeroever est un poing dans la gueule de l'industrie du cinéma. Un direct bien réaliste, un drame qui s'enfonce lentement dans le mystère fantastique aux ramifications païennes. Un peu comme l'histoire du village construit sur un cimetière amérindien, sans les clichés, ni les travellings, ni la gentille fin pour laisser le spectateur respirer. Linkeroever étouffe progressivement, graduellement, pourtant il ne dure que 98 minutes, ce qui fait trente minutes de moins que ce qu'il en faudrait à hollywood pour faire le même film à moitié vide.
Hier soir, j'ai dérobé la cassette vidéo de Linkeroever dans le sac d'une grand-mère. Que faisait-elle là (la cassette, pas la mamie) ? l'histoire ne le dira jamais. L'Histoire, elle, devrait raconter que Linkeroever est un poing dans la gueule de l'industrie du cinéma. Un direct bien réaliste, un drame qui s'enfonce lentement dans le mystère fantastique aux ramifications païennes. Un peu comme l'histoire du village construit sur un cimetière amérindien, sans les clichés, ni les travellings, ni la gentille fin pour laisser le spectateur respirer. Linkeroever étouffe progressivement, graduellement, pourtant il ne dure que 98 minutes, ce qui fait trente minutes de moins que ce qu'il en faudrait à hollywood pour faire le même film à moitié vide.
On pourra toujours arguer que c’est un film fauché, c’est sûrement vrai, que l’économie de sa réalisation est une résultante de cet état de fait, on aura probablement raison. On pourra toujours dire qu’il s’agit de roideur volontaire, hypnotique, artistique, un choix délibéré, etc. et on aura peut-être raison.
Mais alors, il faut se demander pourquoi un film serait plus intéressant parce qu’il bénéficie d’une réalisation fantasque, un montage frénétique, des effets de post-production pléthoriques… Cela voudrait dire que Bad Boys est un meilleur film policier d’action que Die Hard. Je pose la question. Même si j'en doute.
Comme la réponse à ces questionnements n’existe pas plus que celle qui concerne « Les meilleurs XX », je passe à la suite.
Linkeroever ne peut ni ne doit ressembler à aucun flim industriel, il en perdrait son âme. Linkeroever ressemble à un film fauché avec des plans fixes… et une ambiance, un ton et un récit singulier. L’épilogue est déconcertant et rien que pour ça...
Crawl, Alexandre Aja (2019)
 Crawl ou Terreur Dans La Tempête est un long-métrage cinématographique dicté par Paramount et la société de production de Sam Raimi. Il est filmé par Alexandre Aja.
Crawl ou Terreur Dans La Tempête est un long-métrage cinématographique dicté par Paramount et la société de production de Sam Raimi. Il est filmé par Alexandre Aja.
À quoi s'attendre si ce n'est un film conçu pour faire bouffer du pop-corn à des américons en les ventousant à leur strapontin ? Euh... rien ou pas grand-chose.
Film d'horreur d'action aux effets spéciaux numériques... effets réussis tant qu'ils n'essaient pas d'imiter une créature vivante. Quand c'est le cas, tout particulièrement pour les crocodiles, ça devient risible. Qui peut croire à des crocros pareils ? En revanche, les effets spéciaux numériques sont acceptables pour ce qui concerne la tempête et ses conséquences. A minima, ça évite de gaspiller des centaines de milliers de litres d'eau. Ceci dit, surconsommer des ressources vitales, ce n'est pas ce qui fait peur à hollywood et l'industrie du cinéma.
Pour revenir à nos crocros – les fameuses créatures qui « étaient là avant nous » comme le clame une des affiches (plus ridicules, c’est possible ?) – totalement irréalistes de par leur nature pixelisée, ils manquent cruellement de cohérence tellement ils deviennent lents, maladroits et faibles dans l’eau comme à l’extérieur. L’héroïne, avant de leur échapper à la nage (!), se fait happer la jambe puis le bras sans autre conséquence que des marques rouges après quelques grimaces de douleur. On parle bien de crocodiles, un des prédateurs les plus redoutables du règne animal. Ça fait désordre.
Pour conclure ce chapitre du ridicule, je dois préciser que les reptiles émettent des grognements d'une autre espèce, King Kong ou Godzilla, peut-être, mais pas de croco !
Tout ceci ne peut fonctionner que grâce à un énorme effort de suspension consentie de l'incrédulité… ou beaucoup de pop-corn.
J’avais déjà du mal avec ce qui précède quand la rengaine familiale avec son cortège de culpabilités croisées qui se résolvent en deux phrases m’a achevé. Comme si cela donnait du corps aux personnages, ils ont tous, toujours, un problème de culpabilité envers un des membres de leur famille... C'est toujours la même chose ! Dans chaque film, et ça ne choque personne !
Merci Alexandre, j’espère que tu es heureux de bien gagner ta vie et d’avoir réalisé ton rêve en intégrant cette grande foire qu’est hollywood.
Abigail, Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett (2024)
 L'autre soir, ou plutôt l'autre après-midi, un peu désœuvré, je me suis rendu chez mes amis libanais qui font du commerce de location de cassettes vidéos en tout genre. Machinalement, j'ai filé au rayon des films dits d'horreur et, toujours aussi machinalement que si j'avais été un des personnages centraux d'une célèbre et prophétique série de romans d'Asimov, je me suis emparé de la première cassette à portée. Par définition, ces cassettes sont celles destinées à être écoulées en nombre, exposées en tête de gondole, accompagnées de photos promotionnelles à visée sensationnelle. Portés par leur distributeur, fréquemment une société énorme venue d’outre-Atlantique…
L'autre soir, ou plutôt l'autre après-midi, un peu désœuvré, je me suis rendu chez mes amis libanais qui font du commerce de location de cassettes vidéos en tout genre. Machinalement, j'ai filé au rayon des films dits d'horreur et, toujours aussi machinalement que si j'avais été un des personnages centraux d'une célèbre et prophétique série de romans d'Asimov, je me suis emparé de la première cassette à portée. Par définition, ces cassettes sont celles destinées à être écoulées en nombre, exposées en tête de gondole, accompagnées de photos promotionnelles à visée sensationnelle. Portés par leur distributeur, fréquemment une société énorme venue d’outre-Atlantique…
La digression élève l’homme : « Venue » n’est pas de mise dans notre monde malade de ses tentatives suicidaires pour abolir les distances entre producteurs et consommateurs. Universal n’a plus besoin de « venir » de nulle part sur terre, Universal est partout, comme les rats ou les fourmis, les cons ou les compromissions.
Portés par leur distributeur, fréquemment une société énorme venue d’outre-Atlantique, disais-je, ces films, mis en avant partout où on peut se permettre de payer le droit de les visionner, peu importe le support, sont formatés pour satisfaire le plus grand nombre.
Hélas, je ne suis pas le plus grand nombre.
Je ne me souviens pas avoir assisté à pareille lapidation du mythe du vampire. Peut-être que si maître Begbeider s’abaissait à gober un acide ou deux comme au bon vieux temps, peut-être ferait-il mieux. J’en doute, maître Begbeider est entré en littérature…
Non seulement Abigail, le film, n’a aucune ambition, mais Abigail, le personnage, n’a aucune consistance. Peut-être son interprète rêve-t-elle déjà d’oscar puisqu’elle est entrée avec ce film dans la fratrie des grands grimaciers d’hollywood, mais jamais elle n’incarne. Il faut dire que les auteurs n’ont rien fait pour rendre Abigail, le personnage, intrigant ou en faire un objet de curiosité, il n’ont fait que pousser une idée dans les filets du ridicule : une enfant vampire avec un tutu qui fait des pointes en saignant ses victimes. Ce n’est pas tout, Abigail est la fille d’un vampire séculaire qui a bâti un empire du crime et qui se venge de 3-4 crétins sans épaisseur qui lui ont fait perdre de l’argent ! Peut-on imaginer synopsis plus idiot, plus involontairement satirique ? Oui, dans les détails, tous les détails, si nombreux, si embarrassants que c’est à se prendre pour un hater.
La prochaine fois que je serai désœuvré, je tâcherai de me souvenir d’Abigail et j’irai au fond du rayon horreur…
Sombre, Philippe Grandrieux (1998)
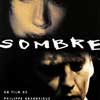 L'autre jour, j'ai revu Sombre, le film noir de Grandrieux, sur un vieux DVD dont je n'ai plus idée de l'origine.
L'autre jour, j'ai revu Sombre, le film noir de Grandrieux, sur un vieux DVD dont je n'ai plus idée de l'origine.
Factuellement, ce métrage ne raconte rien, il montre ; et ce qu'il montre, il le rend laid, inaudible ou lacunaire. Ou magnifique, sensuel et métaphysique. Au choix. Celui du spectateur. Encore une question de ressenti, d'affinités… Grandrieux cadre souvent serré, couvre ses images d'une pénombre qu'on peut trouver disgracieuse, pénible ou divine, significative… Ses personnages n'ont d'existence que dans le moment du cadrage, ils n'ont pas d'histoire, on les rencontre et ils ne répondent pas aux questions. On doit se contenter d'observer. Le premier de ces personnages tue des jeunes femmes. La seconde passe par là. Ils se croisent et on peut comprendre qu'ils vont s'aimer – même un bref instant, pour la fable – pour on ne sait quelle raison, envers et contre toutes les évidences. Dans un monde sombre qui est le nôtre. Dans ce monde violent qu’évoque Grandrieux ; ce monde laid que dénonce Grandrieux ; ce monde sans amour que constate Grandrieux.
1h50 de plans serrés, de gémissements, de râles, de pluie battante, de personnages secondaires laids comme le monde des Hommes. Un monde dans lequel tout est possible, malgré le désespoir, la preuve avec ces deux personnages.
C’est moche, c’est beau, c’est inepte et visionnaire. C’est un film.